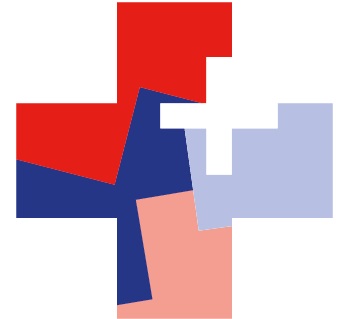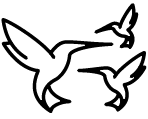L'actu de l'académie de Toulouse
Comment accueillir un élève de seconde générale et technologique en stage d’observation
Mise à jour : avril 2024
Lire le contenuPréparation de la rentrée scolaire 2024 dans l’académie de Toulouse
Mise à jour : février 2024
Lire le contenuDirections des services départementaux de l'éducation nationale
Numéros utiles
Non au harcèlement : un numéro unique
École inclusive
|
En direct des écoles et établissements
Forum Passion Métiers pour les élèves de Sainte-Claire dans le Tarn-et-Garonne
Mise à jour : avril 2024
Lire le contenuLes infos nationales

Choc des savoirs : une mobilisation générale pour élever le niveau de notre École

Une nouvelle terminale en voie professionnelle à la rentrée 2024

Un professeur, ça change la vie pour toute la vie
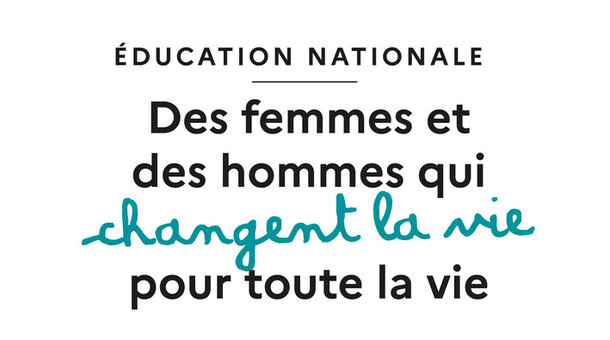
Revalorisation des rémunérations, des carrières et des missions des professeurs

Contacter l'académie de Toulouse
Académie de Toulouse
75, rue Saint Roch
31400 Toulouse
Tél. : 05 36 25 70 00
Avant d'adresser toute demande ou question, veuillez consulter la foire aux questions pour vérifier si la réponse n'y figure pas.
Venir au rectorat
Rectorat de l'académie de Toulouse
75, rue Saint Roch
31400 Toulouse
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Écrire au rectorat
Rectorat de l'académie de Toulouse
CS 87 703
31077 Toulouse cedex 4
Tél. +33 (0)5 36 25 70 00